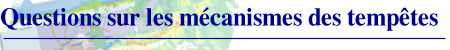
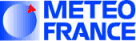



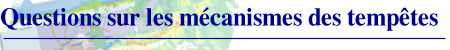 |
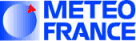 |
Figure 28 :A partir du 26 décembre après-midi, la tempête T2 s'organise dans une configuration favorable à son développement (comme sur le schéma 6), avec un précurseur d'altitude. Celui-ci peut être matérialisé et observé de différentes manières. Entouré par le trait blanc, il est ainsi visible le 27 décembre à 0 h TU sur une image de l'un des canaux du satellite géostationnaire METEOSAT, canal sensible à la distribution de vapeur d'eau vers 8--10 km d'altitude. Sur ce traitement en fausse couleur, le noir correspond à des zones humides, le jaune à des zones sèches: le précurseur est en effet composé d'air très sec d'origine stratosphérique.
Figure 29 :Cette figure reprend une partie des champs des figures 19 à 31: le courant-jet d'altitude en surfaces bleues et les événements dépressionnaires en lignes mauves. Ici, pour comparer avec la mesure de satellite montrée sur la fig. 28, on a ajouté la forme de la tropopause, cette surface qui sépare l'atmosphère météorologique de la stratosphère (voir schéma 7) (lignes beiges, intervalle 1 km, l'altitude 8 km étant renforcée). Le précurseur d'altitude est une zone où la tropopause est enfoncée de plus de 4 km dans l'atmosphère météorologique: il est très intense et continue de s'intensifier, de concert avec la dépression T2.
|
La tempête T2 prend la forme caractéristique des forts creusements
de dépressions: cette forme, résumée par le schéma 6 qui
illustre la réponse 6, est illustrée par les
figures 28 et 29. Ces figures montrent la structure
du système en altitude. Quelques heures après, le 27 décembre à 12 h, on retrouve T2 en train de passer sous l'axe du courant-jet dans le golfe de Gascogne. Elle prend rapidement de l'intensité, elle atteint son maximum juste avant de frapper nos côtes. |
Figure 30 :Synthèse de la situation: légende détaillée avec la carte 19
Figure 31 :Synthèse de la situation: légende détaillée avec la carte 19
|
Le 27 décembre à 18 h,
la tempête T2 est passée au nord du jet. Elle a maintenant plus que doublé
en intensité, qui est maximale à cet instant, juste sur les côtes ouest de la
France. On
remarque que le courant-jet est fort essoufflé: ceci traduit la
consommation de l'énergie thermique par les deux tempêtes successives.
La figure 33 résume son cycle d'évolution caractérisé par une
phase océanique complexe, hésitante suivie par une phase de développement
soudain assez classique dans son mécanisme. Ce scénario explicatif est encore provisoire. Pour le confirmer, nous utilisons une technique de modification de l'état de l'atmosphère simulé, de sa représentation numérique. Il est ainsi possible d'ôter ou de modifier tel ou tel élément qui nous semble important à un moment donné, puis de simuler ce qui arrive après modification. Il faut donc procéder étape par étape. Ce travail est en cours. On trouvera quelques précisions: |



