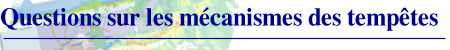
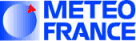



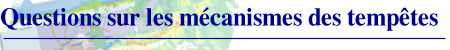 |
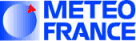 |
Figure 11 :La pression réduite au niveau de la mer (en noir, tous les 5 mbar) et le module du vent vers 1500 m d'altitude, le 26 décembre à 06 h. Noter la structure horizontale des vents les plus forts (en bleu), une tache dans le secteur sud du minimum de pression (voir fig. 12). Elle se prolonge vers le sud-ouest par un tube de vent fort caractéristique de la formation d'un front.
|
Une dépression est donc une sorte de machine naturelle qui fabrique du
vent en brassant de l'air d'une certaine manière (on l'a vu
en 6).
En plongeant dans les
détails du fonctionnement, on découvre que la création de vents forts se
fait avant tout au niveau même du courant-jet. Ce dernier s'en trouve
modifié, ce qui a des conséquences
sur les dépressions qui suivent. Les mécanismes de création de vent
sont aussi très efficaces
un peu au-dessus du sol.
(Juste au sol, cette création est contrariée
par le frottement.) De là les dégâts du vent qui s'organise, avec
l'amplification de la tempête, en sorte de petits courants-jets situés à
peine à 1 ou 2 km du sol (fig. 11).
Ce vent fort n'est pas «transporté» du haut vers
le bas mais créé comme est créé le mouvement des roues d'une voiture, par
une transformation thermodynamique motrice. Dans le cas des tempêtes de
décembre 1999, le vent propre à cette évolution de la tempête ajoute
ses effets à un vent d'ouest déjà assez fort (fig. 12). Avec ces mini-courants-jets près du sol, on assiste donc à la formation de nouvelles structures alors même que le moteur fonctionne à plein régime: ce sont les fronts atmosphériques. Dans les fronts se concentrent les effets des dépressions: maximum de pluie, maximum de vent, maximum de variations horizontale et verticale du vent, d'autant plus localisés que le front est intense. |
Figure 12 :Une interprétation de la situation près de la surface pendant la première tempête. Elle se décompose en un élément de grande échelle (en bleu), qui est la trace sur notre pays de la vaste circulation cyclonique qui s'est installée depuis le 23 de la France à l'Islande. On pourrait aussi dire que cette composante accompagne la présence du courant-jet. Cette composante donne, à elle seule, un vent de 20 m/s soit 70 km/h. Là-dessus se superpose la tempête (en vert), qui, en se développant atteint aussi des vents «propres» du même ordre. Pris séparément, ces éléments n'ont rien d'exceptionnels. Mais la superposition a de terribles effets. Au sud du centre dépressionnaire, les deux vents s'ajoutent (140 km/h en moyenne). Au nord, en revanche, le vent de la tempête s'oppose au vent de plus grande échelle, créant une zone très calme.
|
On est passé d'une grande organisation en ligne, le rail des dépressions,
(longueur 4000 km) à une organisation
plus petite et tourbillonnaire, les dépressions
(diamètre 2000 km et moins). On vient de voir que l'explosion des dépressions en
tempête crée, en leur sein, de nouvelles structures encore plus petites,
mais de nouveau en ligne, les fronts. Dans des cas extrêmes, eux-mêmes peuvent dégénérer en tourbillons de quelques dizaines de km de diamètre (fig. 13). Connus sur l'océan depuis une campagne américaine de 1989, vus en Méditerranée, ces tourbillons, très localisés, sont d'une rare violence. Leur observation sur la terre ferme, qui nécessiterait soit un avion piloté par un équipage téméraire soit un ou des radars Dopplers, reste à établir, mais ce peut être une explication à des vents encore plus destructeurs dans des régions très localisées. |
Figure 13 :Exemple de vortex observé le long d'un front chaud intense en janvier 1989 au large de la Côte Est de l'Amérique. Ici, la taille caractéristique n'est plus que de 20 km. Figure extraite de Neiman et al. (1993).



