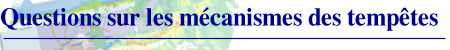
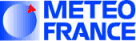



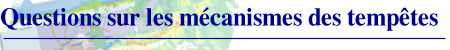 |
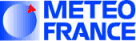 |
Figure 6 :Ce schéma représente un courant-jet rectiligne idéalisé: la géométrie de ce schéma et de ses analogues est donnée par la fig. 7. Dans ce courant-jet, composante du rail des dépressions, une tempête se développe. Composée de deux tourbillons (un en surface, l'autre en altitude) situés comme indiqué l'un par rapport à l'autre (celui de surface situé à l'est de celui d'altitude), elle s'amplifie et fabrique du vent tel un moteur atmosphérique. Ce moteur transforme l'énergie thermique associée au courant-jet (fig. 7) en vent, en particulier en surface. Le cycle thermodynamique moteur est réalisé au moyen de la circulation d'air selon la verticale, dimension essentielle pour comprendre les tempêtes. Ce type de configuration semble pouvoir être appliqué à la plus grande partie de l'évolution de la seconde tempête (Voir synthèse, fig. 33).
|
Une analogie simple résume l'essentiel: les dépressions sont un
moteur naturel et provisoire
qui transforme en vent «l'essence» contenue dans le rail des
dépressions (fig. 6).
L'idée est la même que pour l'automobile. Avec un réservoir
d'essence posé sur des roues, on ne va guère loin.
L'énergie (chimique) contenue dans l'essence ne constitue qu'un potentiel
qui ne va pas spontanément se convertir
en énergie cinétique (en vitesse).
La vitesse des roues et
de l'automobile est crée par le mélange de l'essence et de l'air au sein
d'un arrangement particulier des pièces mécaniques qui constituent le
moteur. Dans l'atmosphère, l'essence est stockée le long du rail sous la forme d'un contraste thermique horizontal sur une épaisseur de 8--9 km sur la verticale. Ce contraste représente une énergie potentielle convertible en vent (figure 7). L'essence, à elle seule, n'explique en rien le mouvement des voitures: de même, affirmer qu'il y a un fort contraste thermique dans le rail des dépressions n'explique en rien les tempêtes. Tout au plus, relevons un point commun aux deux composantes de cette analogie simpliste: dans les deux cas, le contraste thermique influence le rendement du moteur. On ne peut entrer ici dans les détails du fonctionnement du moteur. Disons simplement que, comme un bon moteur voiture dépend de la synchronisation du piston et de l'étincelle, l'augmentation du vent dans une dépression dépend de la synchronisation, au sein du rail, d'un modeste tourbillon précurseur vers 9 km d'altitude et d'un autre, décalé vers l'est, près du sol (figure 6). Une paire de tourbillons d'altitude de signes opposés offre une possibilité de variante, comme le diésel à l'essence. Ces tourbillons sont un peu comme ceux que l'on peut voir naître et disparaître en regardant couler une rivière. Le renforcement général des flux à des distances éloignées du centre de la dépression dépend avant tout du moteur qu'elle constitue. Les dépressions précédentes et suivantes aussi, ce qui complique un peu. Mais là se situe l'unique source des mouvements de l'air dans et autour du rail. Ce n'est donc pas «l'alimentation» en air chaud ou froid qui fait la dépression, c'est la dépression, source du vent et donc des déplacements d'air, qui fait circuler autour d'elle l'air qui lui permettra de s'amplifier davantage ou non. L'analogie simpliste avec une automobile est utile, mais elle est limitée. Ainsi, l'idée développée dans la réponse à 5, la notion de variabilité interne sans cause externe, ne trouve guère son équivalent dans le système très rigide que constitue une voiture, dans les machines inventées par les hommes en général. Toutefois, les considérations énergétiques mises en avant ici ne doivent jamais être perdues de vue. |
Figure 7 :Ces schémas décrivent le milieu nécessaire à la formation et à la croissance des dépressions, dans un cadre simplifié. Le premier élément est la présence du courant-jet, tube de vent fort, indiqué ici avec le code d'orientation commun à tous les schémas (en haut). Le courant-jet n'agit pas sur la situation en tant que tel (sauf à ses extrémités), il symbolise et marque la présence d'un réservoir d'énergie potentielle thermique qu'un moteur atmosphérique pourrait convertir en vent, en tempête (en bas). Des surfaces isothermes en pente représentent plus directement cette énergie, mais nuisent à la lisibilité. Comme ces surfaces sont étroitement associées au courant-jet (par une loi d'équilibre due à la rotation de la Terre), on peut se dispenser de les représenter à chaque fois, le courant-jet symbolisant à lui seul l'ensemble de ce que montre le schéma du bas.



