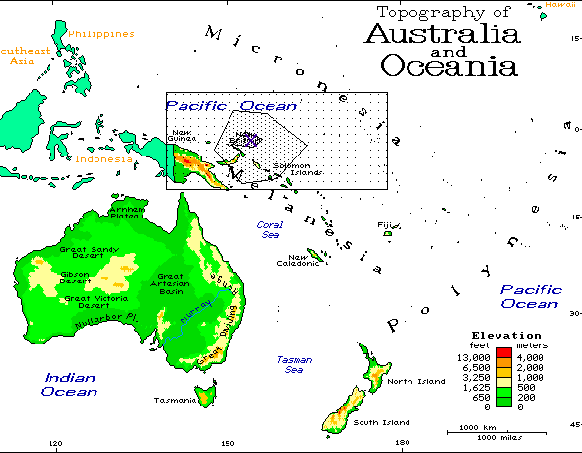 |
Le programme international TOGA a été lancé en 1985, pour une durée de 10 ans, dans le cadre du Programme Mondial de Recherche sur le Climat (PMRC), commun à l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et au Conseil International des Unions Scientifiques (CIUS).
Le programme TOGA a pour objectifs :
L'importance de la région du pacifique ouest dans la génèse des évènements ENSO, les difficultés pour comprendre et modéliser le couplage océan-atmosphère très marqué de cette région (mauvaise connaissance particulièrement des flux à l'interface et des systèmes précipitants), ont rendu nécessaire le développement d'une expérience étudiant de manière intensive tant au niveau atmosphérique qu'océanique, la région du pacifique tropical ouest: COARE.
Le programme TOGA-COARE a pour but de décrire et de comprendre, dans cette région d'eaux chaudes du pacifique ouest :
L'expérience COARE a fait appel à un effort de recherche international.
Plus de 700 techniciens, ingénieurs et scientifiques
d'une vingtaine de nations, ainsi que les
équipages de 13 navires (australien, chinois, français, japonais et
américains) et de 7 avions (australien, britannique et américains), ont
participé en effet à l'obtention de ces observations.
L'intérêt premier de COARE est de réunir dans cette région tropicale
clé
des moyens d'observation à la fois de l'atmosphère, de l'océan et des
échanges entre les deux milieux. Les instruments de mesure déployés
dans l'expérience COARE représentent ce que la communauté internationale
sait faire de mieux à l'heure actuelle. Cette concentration de moyens a
été déployée à l'intérieur d'un réseau de trois domaines
imbriqués
d'échelles spatio-temporelles décroissantes (Figure 1.1).
Le domaine le plus grand couvre une région de 4000 km de long sur 2000 km
de large (LSA) avec un système de sondages verticaux renforcés, permettant
la description de la circulation atmosphérique à cette échelle. A
l'intérieur de cette maille, une zone plus restreinte (OSA), formant un
hexagone de 1000 km de coté, est dédié à la documentation des
systèmes précipitants (Fig. 2). Dans cette région, les 7 avions mis en
oeuvre ont effectué de nombreuses mesures et de hautes cadences de sondages
verticaux ont été effectués (6 radars ST mesurant le vent en continu
étaient par exemple présents). Les mesures realisées dans cette zone
permettront de déterminer précisement les transferts horizontaux et
verticaux d'eau et de chaleur effectués par les systèmes précipitants.
Les radars Doppler sur bateaux et sur avions sont des éléments clés
dans cette détermination. Au sein de l'OSA, dans un carré de 500 km de
coté (IFA), un grand nombre de moyens de mesure de flux de surface ont
été réunis sur plusieurs bateaux et sur des mouillages.